La génétique de l’hôte joue un rôle clé dans l’évolution de la COVID-19. Alors que les études précédentes se sont concentrées sur les variants communs, cette analyse a exploré l’impact des variants rares sur la sévérité de la maladie en combinant des données de séquençage d’exome et de génome entier provenant de 21 cohortes internationales. L’analyse de 5 085 cas de maladie sévère et 571 737 témoins a révélé qu’un variant délétère rare du récepteur TLR7, impliqué dans la détection du SARS-CoV-2, était associé à une augmentation de 5,3 fois du risque de forme sévère. Cette association, cohérente entre les sexes, confirme le rôle de TLR7 comme facteur génétique de susceptibilité et suggère que l’étude des variants rares pourrait apporter de nouvelles pistes pour le développement de thérapies ciblées
Publications


Évaluation systématique de la génétique de l’hôte du COVID-19 à l’aide de données de séquençage du génome complet.
Cette étude présente les résultats du séquençage du génome entier de 1 220 individus, principalement non vaccinés, infectés par le SARS-CoV-2, dont 827 cas hospitalisés. Nous avons identifié des troubles monogéniques autosomiques récessifs ou des hétérozygoties composées chez six individus, tous hospitalisés et significativement plus jeunes que le reste de la cohorte. Aucun variant causal n’a été trouvé près du gène TLR7. Les tests de charge ont montré des enrichissements de variants rares dans les gènes de la réponse immunitaire aux interférons, particulièrement chez les hommes européens. Des analyses cas-témoins ont confirmé des associations avec des loci de risque déjà identifiés, notamment sur le locus 3p21. Les scores polygéniques ont permis de capturer le risque de manière dépendante de l’âge. Ces résultats contribuent à éclaircir l’étiologie de la COVID-19 en intégrant diverses variations génétiques.
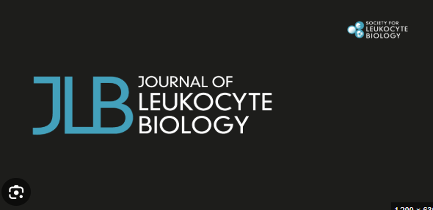
Réponses immunitaires induites par le vaccin à ARNm contre le SARS-CoV-2 dans la polyarthrite rhumatoïde.
Cette étude évalue les réponses des cellules T et B après vaccination contre le SARS-CoV-2 chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) immunodéprimés. Après trois doses de vaccin à ARN messager, six des 22 patients ont montré des anticorps anti-spike, bien que les titres soient demeurés inférieurs à ceux des témoins sains. Les patients ayant répondu à la première dose avaient des anticorps anti-RA et un pourcentage plus élevé de cellules B folliculaires circulantes. Une forte réponse des cellules T CD4+ a été observée après les premières doses, tandis que la réponse des cellules B spécifiques au domaine de liaison au récepteur (RBD) a été plus modeste, avec une augmentation marquée après la deuxième dose chez certains patients. Ces résultats soulignent l’importance de la vaccination multidose pour induire une réponse humorale protectrice, malgré une réponse retardée des cellules B.

L’objectif de cette étude était de valider en externe deux scores de risque simples pour prédire la mortalité chez une population majoritairement hospitalisée atteinte de COVID-19 au Canada (588 patients pour COVID-NoLab et 479 patients pour COVID-SimpleLab). Les taux de mortalité dans les groupes à faible, modéré et haut risque étaient respectivement de 1.1 %, 9.6 % et 21.2 % pour COVID-NoLab, et de 0.0 %, 9.8 % et 20.0 % pour COVID-SimpleLab, des valeurs cohérentes avec celles de la cohorte d’origine. Ces deux scores, désormais validés en externe, permettent aux cliniciens d’identifier rapidement les patients hospitalisés à faible risque qui pourraient être pris en charge en ambulatoire en cas de saturation des lits hospitaliers.

L’IL-17F circulante, mais pas l’IL-17A, est élevée dans les cas graves de COVID-19 et entraîne une augmentation dépendante de l’ERK1/2 et de la p38 MAPK de l’expression de l’ICAM-1 à la surface cellulaire et de l’adhésion des neutrophiles sur les cellules endothéliales.
L’inflammation neutrophilique et l’immunothrombose jouent un rôle clé dans les formes sévères de COVID-19. En analysant des échantillons de la Biobanque québécoise de la COVID-19 (BQC19) et d’une cohorte indépendante, une élévation des cytokines IL-17D et IL-17F a été observée chez les patients COVID-19, avec des niveaux plus élevés chez ceux atteints de formes sévères. Des expériences in vitro ont montré que l’IL-17F favorise l’adhésion des neutrophiles aux cellules endothéliales via l’augmentation de l’ICAM-1 à leur surface, un processus atténué par des inhibiteurs de la voie MAPK. Ces résultats suggèrent que l’IL-17F pourrait contribuer à l’immunothrombose dans le COVID-19 sévère en facilitant l’activation endothéliale et l’adhésion neutrophilique.

Après une infection par le SARS-CoV-2, une proportion importante de personnes convalescentes développe la condition post-COVID (PCC), caractérisée par des symptômes affectant divers organes. Cette étude a exploré les réponses des cellules B et des anticorps spécifiques aux antigènes du SARS-CoV-2 chez des patients atteints de PCC après une forme légère de COVID-19. Les résultats montrent que, bien que les réponses des cellules B spécifiques au D614G RBD soient comparables entre les groupes convalescents avec et sans PCC, des différences notables ont été observées en fonction du sexe. Chez les femmes atteintes de PCC, la réponse des cellules B et des anticorps anti-spike était plus élevée que chez les hommes, suggérant que des facteurs liés au sexe peuvent influencer le développement de la PCC en modulant les réponses anticorps aux antigènes du SARS-CoV-2.

Développement d’un modèle d’apprentissage automatique basé sur l’ARN non codant long pour prédire la mortalité hospitalière liée à la COVID-19.
Le développement d’outils prédictifs pour les issues de la COVID-19 permet une prise en charge personnalisée et pourrait alléger le fardeau de la maladie. Cette étude collaborative menée par 15 institutions européennes a développé un modèle d’apprentissage automatique pour prédire le risque de mortalité hospitalière post-infection au SARS-CoV-2. En analysant des échantillons sanguins et des données cliniques de 1286 patients issus de cohortes en Europe et au Canada (2020-2023), 2906 longs ARN non codants ont été profilés par séquençage ciblé. Dans une cohorte de découverte de 804 patients européens, l’âge et l’ARN LEF1-AS1 ont été identifiés comme variables prédictives, avec une AUC de 0.83 (IC 95% 0.82–0.84) et une précision équilibrée de 0.78 (IC 95% 0.77–0.79) via un classificateur par réseau neuronal. Une validation dans une cohorte canadienne indépendante de 482 patients a confirmé ces performances. Une analyse de régression de Cox a montré qu’une expression élevée de LEF1-AS1 était associée à une réduction du risque de mortalité (HR ajusté sur l’âge = 0.54, IC 95% 0.40–0.74). La PCR quantitative a validé son adaptabilité en milieu hospitalier. Ce modèle prédictif constitue une avancée prometteuse pour l’optimisation de la gestion des patients COVID-19

L’élimination de l’ARN du SARS-CoV-2 dans le plasma et la cinétique du RAGE permettent de distinguer la gravité de la COVID-19.
L’identification de biomarqueurs influençant la cinétique d’infection par le SARS-CoV-2 est essentielle pour optimiser le diagnostic et les stratégies thérapeutiques de la maladie COVID-19 sévère. En appliquant un modèle mathématique simple aux dynamiques de l’ARN viral plasmatique (vRNA) chez 256 patients hospitalisés, cette étude a révélé que les taux de clairance distinguent les profils de progression de la maladie. De plus, une forte corrélation a été observée entre la cinétique du vRNA et les concentrations plasmatiques du récepteur des produits de glycation avancée (RAGE), un biomarqueur de lésions pulmonaires, suggérant que RAGE pourrait servir d’indicateur substitutif pour classifier les patients gravement atteints. Ces résultats soulignent l’intérêt des modèles mathématiques pour décrypter les mécanismes de la COVID-19 et orienter les interventions visant à accélérer l’élimination virale.

Analyse génomique des cas graves de COVID-19 avec ou sans comorbidité asthmatique : conclusions de l’étude GWAS menée sur la cohorte BQC19.
Cette étude explore l’influence des facteurs génétiques sur la sévérité de la COVID-19, en particulier chez les patients asthmatiques. En analysant 2131 échantillons de la Biobanque québécoise de la COVID-19 (BQC19), dont 1499 cas positifs, les chercheurs ont identifié sept variantes génétiques associées aux formes sévères de la maladie, impliquant notamment les gènes SCN10A, DSP, RP1, IGFL1 et DOK5. Chez les patients asthmatiques atteints de formes sévères, quatre autres variants ont été trouvés dans les gènes TMEFF2 et HIP1. Ces résultats contribuent à une meilleure compréhension des facteurs génétiques influençant la gravité de la COVID-19.

L’analyse des facteurs génétiques de l’hôte permet de mieux comprendre la sévérité et la susceptibilité à la COVID-19. Cette étude présente une mise à jour de l’étude d’association pangénomique (GWAS) du COVID-19 Host Genetic Initiative, incluant jusqu’à 219 692 cas et plus de 3 millions de témoins. Elle identifie 51 loci significatifs, dont 28 nouveaux, impliqués dans trois voies biologiques majeures : l’entrée virale, la défense des voies respiratoires et la réponse interféron de type I. Ces découvertes affinent notre compréhension des mécanismes génétiques influençant la maladie et ouvrent des pistes pour le développement thérapeutique.